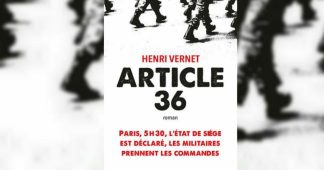Une autre histoire du néolibéralisme
[Note de lecture]
paru dans lundimatin#284,
le 19 avril 2021
Dès ses origines, le néolibéralisme a fait le choix de « la guerre civile contre l’égalité au nom de la “liberté“ » en vue de réaliser le projet d’une pure société de marché, prenant des formes diverses, selon les circonstances, pour écraser ses ennemis : se dotant des moyens de la coercition militaire et policière ou se confondant avec l’exercice du pouvoir gouvernemental et se menant par le droit et la loi. « Relire le néolibéralisme sous l’angle de la rationalité stratégique et de la violence qui lui est intrinsèque, c’est remettre en question son interprétation théorique comme ensemble de doctrines ou positions purement idéologiques, et c’est par conséquent analyser le terrain sur lequel il se déploie et qui n’est autre que celui d’une lutte sociale et politique pour imposer sa domination. » [1]
[1] Cette note de lecture nous a été transmise par la…
Pierre Dardot, Haud Guéguen, Christian Laval et Pierre Sauvêtre définissent ces « guerre civiles » du néolibéralisme comme des guerre « totales », menée à l’initiative de l’oligarchie, guerres sociales, ethniques, politiques et juridiques, culturelles et morales, en réponses « aux formes de régulation sociale de l’économie que le suffrage universel et la démocratie partisane ont imposées au libre marché dans les années 1920, grâce aux succès électoraux des partis sociaux-démocrates et au recours à la planification économique de la part de gouvernement élus ». L’expérience de la social-démocratie en Autriche et la république de Weimar en Allemagne ont suscité l’effroi des néolibéraux qui souhaitaient alors « empêcher la démocratie d’empiéter sur l’économie » par la mise en place d’un État fort et la répression des forces et mouvements sociaux opposés à ce projet. Le marché concurrentiel fonctionne comme l’équivalent d’un impératif catégorique qui permet de légitimer les mesures les plus excessives, y compris le recours à la dictature militaire lorsque l’ordre du marché parait directement menacé dans son existence même, comme au Chili en 1973. Le néolibéralisme est « un projet de neutralisation du socialisme sous toutes ses formes ». « Les guerres du néolibéralisme sont à la fois des guerres pour la concurrence et contre l’égalité. »
Les auteurs reviennent sur le coup d’état mené le 11 septembre 1973 par le général Pinochet avec le soutien actif de Richard Nixon et de la CIA, mettant fin à l’expérience de l’Unité populaire amorcée en 1970 par la victoire de Salvador Allende. Si une « politique gradualiste » est tout d’abord suivie, jusqu’en 1975, pour « stabiliser les variables macro-économiques moyennant un programme d’austérité tempérée », une politique de « destruction créatrice » est adoptée ensuite, avec l’aide des Chicago Boys de Milton Friedman, « selon une stratégie consciente de construction sociale menée par l’État en vue de détruire les formes institutionnelles dans lesquelles les relations sociales étaient alors encastrées », détruisant des pans entiers de l’industrie, projetant une partie importante des salariés dans le chômage et provoquant un effondrement des salaires. Par des lois promulguées entre 1978 et 1980, le régime introduit un nouveau code du travail, puis, de 1978 à 1982, plusieurs réformes imposent une privatisation partielle ou totale des retraites, de la santé, de l’éducation, de la justice, du secteur agricole et agraire,… Une nouvelle Constitution, promulguée en 1980, imposera un « verrou juridique » chargé de rendre par avance impossible tout changement d’orientation dans les politiques gouvernementales. Selon le principe de « subsidiarité », l’État n’intervient plus sur la sphère des marchés que lorsque les parties privées ne le font pas. Puis, en 1989, une banque centrale indépendante est créée, isolée de l’influence du ministère de l’Économie et des Finances. Il s’agit toujours de « “dépolitiser“ la direction macro-économique en la retirant du champ d’action de la politique démocratique pour la confier à un conseil de technocrates susceptibles de garantir la continuité des objectifs et des mécanismes établis pendant la période de Pinochet ». Les auteurs analysent en profondeur tous les mécanismes juridiques successivement mis en place, jusqu’aux fonctions attribuées en 2005 au Tribunal constitutionnel qui peut désormais faire obstacle au vote d’un projet émanant des représentants élus.
Les représentants des principaux courants du néolibéralisme mondial, hayékiens, friedmaniens, ordolibéraux, réunis au congrès de la société du Mont Pèlerin en novembre 1981, se félicitent du « nouvel ordre chilien instauré par Pinochet », convaincus que « la démocratie est une menace potentielle pour la liberté et la civilisation » et que les réformes les plus fondamentales ne peuvent être mises en œuvre que dans le cadre de régimes autoritaires. Cette critique de la démocratie est une question centrale « dans la mesure où la démocratie y est envisagée comme la matrice du pire danger pour les sociétés, que les néolibéraux appellent le “collectivisme“ ». « Le néolibéralisme comme entreprise théorique s’est construit autour d’une délégitimation constante de la “démocratie de masse“, conçu comme un obstacle qu’il fallait surmonter. Envisagé comme pratique politique, il a consisté à tester une large gamme de moyens visant à la neutraliser. » « La doctrine néolibérale se présente comme une théorie des limites institutionnelles à apporter à la logique de la souveraineté populaire », dans la mesure où celle-ci, lorsqu’elle n’est pas maîtrisée, laisse l’État étendre son intervention dans tous les domaines de l’existence. « Le néolibéralisme se présente comme une idéologie de guerre contre la démocratie effective, lorsque les résultats électoraux ou les mobilisations populaires mettent en danger les règles du marché. » Dès le colloque Lippmann de 1938, Louis Rougier distingue la « démocratie libérale », par essence démophobique, de la démocratie fondée sur la souveraineté populaire, qu’il appelle « socialisante » et qui aboutit, selon lui, fatalement à la démagogie puis à l’État totalitaire. La première devant neutraliser la seconde. Hayek considère que la « tyrannie de la majorité » est une coalition d’intérêts dans le but d’obtenir la distribution de privilèges à des groupes particuliers, dans un « mirage de justice sociale ». Cet « antidémocratisme néolibéral » repose sur la croyance en l’incapacité politique et intellectuelle des masses. Très tôt, les rénovateurs du libéralisme ont considéré que pour agir contre les masses, il faudrait les retourner contre elles-mêmes. Pour cela, ils vont théoriser la nécessité d’un « État fort » pour mettre le marché à l’abri des revendications démocratiques, démantelant l’État social, ne cédant pas devant la pression des intérêts sociaux, réprimant, si besoin par la violence, scellant ainsi le lien entre néolibéralisme et autoritarisme. Les auteurs poursuivent leur enquête généalogique en remontant jusqu’à Carl Schmitt et en précisant le point de vue de chacun des principaux théoriciens du néolibéralisme : Rougier propose de construire un ordre politique hors d’atteinte de la « souveraineté populaire », Hayek la « démarchie », un « gouvernement par la règle ». Les premiers néolibéraux réagissaient au communisme et à la poussée de la social-démocratie dans les années 1920 et considéraient la dictature et le recours à la violence d’État comme indispensable pour restaurer le marché contre ses ennemis. Müller-Armack considérait que l’État pouvait agir souverainement pour la liberté entrepreneuriale et supprimer la lutte des classes. Si Ludwig von Mises admettait que le fascisme pouvait servir de « gardien de la civilisation », il pensait que le libéralisme devait rechercher le soutien de la majorité de l’opinion publique à long terme et n’utiliser la violence qu’à court terme.
La « souveraineté du droit », selon l’expression de Hayek, s’oppose explicitement à la « souveraineté du Parlement ». Ainsi, le traité de Lisbonne intègre une forme de « constitution économique européenne » en consacrant les fameuses « règles d’or » (stabilité monétaire, équilibre budgétaire, concurrence libre et non faussée), épargnant l’adoption d’une constitution supranationale d’ordre étatique qui aurait rencontré de vives résistances. Hayek, dans La Constitution de la liberté, défend l’élévation des règles du droit privé au rang de lois constitutionnelles. Après avoir présenté l’architecture de son système à trois étages, les auteurs examinent les exceptions qui justifient des entorses aux principes énoncés : conçu pour neutraliser la souveraineté de l’État, il finit par lui faire une place non négligeable. L’État d’urgence peut être décrété en temps de crise et des pouvoirs exceptionnels confiés à « quelqu’un ». À la réunion du Mont pèlerin de 1981, James M. Buchanan a prévenu ses collègues de ne pas se laisser endormir parler les victoires électorales de Thatcher et Reagan mais de « formuler des moyens constitutionnels pour limiter l’intervention du gouvernement dans l’économie et faire en sorte qu’il ne mettent pas la main dans la poche des contributeurs productifs ».
« Le néolibéralisme, au singulier, est une stratégie politique qui vise des ennemis parfaitement identifiés : le socialisme, le syndicalisme, l’État providence. » Là aussi, les auteurs explorent les différentes théories pour confirmer cette assertion. À propos du syndicalisme, ils distinguent deux approches : son intégration dans ce que les allemands ont appelé l’ « économie sociale de marché », c’est-à-dire la cogestion de la direction des entreprises, et son affaiblissement en le privant de ses moyens de « coercition », principe soutenu par l’école de Chicago notamment. Quant à l’État providence, il est accusé de créer une dépendance accrue de tous à l’égard de sa « bienfaisance », par exemple les retraités, découragés par les cotisations obligatoires de constituer une épargne personnelle. Faute de réussir à mettre complètement à bas les systèmes assurantiels, les responsables politiques néolibéraux se sont efforcés de les affaiblir en restreignant leurs sources de financement ou en rationnant les prestations, instillant surtout l’idée qu’il ne faudrait plus compter dessus. Toutefois le capitalisme a besoin d’une justification à l’inégalité entre les individus : les ressorts de la concurrence entre tous.
Les auteurs présentent ensuite trois stratégies néolibérales distinctes :
- La modernisation des institutions et des subjectivités pour les adapter aux évolutions économiques et technologiques de la division du travail à l’échelle nationale et internationale. Selon Walter Lippmann, la crise est plus sociale qu’économique. « Elle tient au désajustement entre la nouvelle économie mondialisée hautement productive et des habitudes de vie et des mentalités qui correspondent à l’ancien mode de production. » L’action publique et juridique doit réformer la société et changer les individus, notamment ceux qui résistent à cette transformation. « Le néolibéralisme apparaît alors bien comme une machine à broyer toutes les oppositions à une économie globalisée structurée par la norme de la concurrence. »
- Un conservatisme assumé qui vise à restaurer les valeurs traditionnelles, à défendre les communautés organiques et hiérarchiques. Pour Röpke, la civilisation occidentale connaît une « crise totale » due aux transformations morphologiques et morales provoquées par la révolution économique du capitalisme et la révolution politique de la démocratie depuis le 18e siècle. Il recommande une « compensation stratégique » pour réintégrer les individus dans des communautés organiques, seul barrage efficace au collectivisme. Il s’agit d’une « utopie passéiste », l’idéalisation conservatrice d’un capitalisme des petites entreprises contre la division du travail qui a conduit à la constitution de groupes de pression, de syndicats qui mettent l’État sous le joug des intérêts particuliers. Il s’agit de neutraliser l’ « anticapitalisme des masses » en encourageant chaque prolétaire à devenir propriétaire de sa maison, d’un lopin de terre et actions d’entreprises.
- Un évolutionnisme qui concilie traditions et changements. Hayek propose de fournir une « Utopie libérale » pour supplanter le socialisme. La coercition pour défendre les valeurs de la hiérarchie et de la tradition, est nécessaire et légitime lorsqu’une innovation ou les dérives de l’égalitarisme social et de la permissivité morale menacent le système normatif d’une société libre.
« L’idée que la refondation du libéralisme ait pour objectif de préserver la civilisation occidentale de tout ce qu’il la mettrait en danger constitue un fil directeur de la pensée néolibérale. »
Si, dès les années 1930 et 1940, le néolibéralisme dénonçait le « nationalisme économique », il dû s’accommoder de la prolifération des États-nations en articulant la politique comme gouvernement des hommes (l’imperium) et l’économie comme gestion des choses et de la propriété (le dominium) selon un schéma de « double gouvernement du monde », selon la formule de Hayek. Robbiens concevait dès 1937 une « fédération libéral mondiale », Hayek un « fédéralisme inter-étatique » en 1939, par exemple. En fondant le FMI et la banque mondiale en 1944, les accords de Bretton Woods ne privaient pas les États des outils keynésiens leur permettant de protéger leur économie d’une intégration totale dans la concurrence économique mondiale. Les auteurs racontent comment les néolibéraux ont repoussé l’introduction de principes démocratiques dans l’organisation des relations économiques internationales et façonné un droit international privé protégeant la propriété du capital à la manière d’une « constitution économique divisant le monde public des États du monde privé de la propriété ». Les ordolibéraux allemands ont contribué, dès les négociations sur le traité de Rome, à donner à l’intégration européenne la forme alternative d’une constitution économique encadrant un marché concurrentiel et ouvert. « Tout sauf le produit d’une évolution naturelle du capitalisme, la mise en place de la globalisation néolibérale a été le résultat d’une volonté délibérée de se servir du droit supranational comme arme de dissuasion contre toute politique nationale contraire à l’ordre du marché. »
Les auteurs montrent ensuite comment, loin de contester le nouvel ordre européen et mondial, la gauche dite « gouvernementale » l’a adopté activement dans bien des pays dans les années 1980, ne considérant plus les marchés comme des forces antagonistes à réguler mais comme des forces à organiser pour favoriser la croissance, et abandonnant les programmes de redistribution sociale. Cette orientation a entraînée une perte importance du soutien traditionnel des classes populaires et symétriquement aidé au développement d’une droite néolibérale toujours plus à droite.
Margaret Thatcher définit le « néolibéralisme anti-européen » en septembre 1988 à Bruges devant le conseil de l’Europe. Elle condamne le « protectionnisme » et la « bureaucratie » des élites de Bruxelles au nom du « libre-échange », de la « libre entreprise » et des « marchés ouverts ». La nation devient le rempart contre le nouveau globalisme réglementaire et l’Europe « socialisante ». Les thématiques identitaires, souverainistes et racistes de ce « nationalisme concurrentialiste », intégralement adopté par l’extrême droite, sont également reprises par toute la droite et même une partie de la gauche gouvernementale.
« Si le néolibéralisme de gouvernement a réussi à s’imposer comme une force jusqu’ici irrésistible de transformation de la société, c’est grâce à son dédoublement en une version réactionnaire de droite et une version moderniste de gauche. Prise dans sa version de gauche, la gouvernementalité néolibérale a consisté à tourner le dos à la lutte historique pour l’égalité sociale au profit de “causes“ culturelles et morales qui, bien que légitimes, ne sauraient à elles seules remplacer la question centrale des inégalités sociales et économiques entre les classes. Permettant d’occulter l’accord fondamental sur les orientations néolibérales en matière économique, ce déplacement de l’opposition politique sur le terrain des valeurs constitue l’un des phénomènes les plus importants des dernières décennies. Il permet en effet d’expliquer comment le néolibéralisme s’est emparé de l’espace des possibles politiques, et comment la version la plus autoritaire et conservatrice du néolibéralisme a pu triompher dans un certain nombre de pays. » La « guerre des valeurs » s’est substituée à l’affrontement social et sert d’ « exutoire à la colère des victimes du système néolibéral ».
Jusque dans les années 1980 et 1990, la droite conservatrice, réactionnaire, traditionaliste, nationaliste, souvent bigote et au moins implicitement raciste, a mené à l’échelle mondiale une contre-révolution culturelle destinée à balayer l’héritage de mai 68.
La notion de « liberté individuelle » défendue par les nouveaux gouvernements néolibéraux possède un fort potentiel de légitimation, tout en étant le contraire de la liberté-émancipation pensée par les Lumières, puis une grande partie du libéralisme politique classique. Cette nouvelle définition de la liberté proposée par Lippmann dans son prologue d’ouverture du colloque de 1938, « ne désigne plus un ensemble de garantie contre l’oppression individuelle collective, mais un droit d’affirmer un ensemble de valeurs traditionnelles autoproclamées comme équivalent à la “civilisation“ ».
Défendre les frontières de celle-ci passe par la stigmatisation de nouveaux ennemis, ceux de l’extérieur, mais aussi les ennemis politiques et culturels de l’intérieur. « Ce mode de gouvernement par les valeurs fonctionne à la diabolisation des “corps étrangers“ pour assurer l’homogénéité imaginaire du groupe. » Au non du « vrai peuple », l’État s’autorise à exercer des contraintes contre les minorités nuisibles qui ne lui appartiennent pas.
Depuis les années 1980, la gauche a délaissé son combat contre les inégalités économiques pour les valeurs culturelles plus « modernes » des classes moyennes, tout en adoptant grosso modo la politique économique et sociale de la droite. La droite, reprenant certaines valeurs des classes populaires abandonnées par la nouvelle gauche progressiste (le travail, le mérite, la famille, l’autorité), a produit un récit unificateur qui intègre dans une même nation toutes les classes par une recommunautarisation imaginaire de la société, une réidéalisation de l’État souverain et une radicalisation de la liberté individuelle. En jouant du ressort de la xénophobie et le racisme, en nourrissant la haine de certaines catégories de la population contre d’autres, perçus comme des menaces pour leur propre situation, elle a retourné une partie des classes populaires contre pratiquement tous les acquis du mouvement ouvrier, contre l’État-providence, contre le droit du travail et contre les syndicats. Elle a divisé et décomposé le « peuple » en communautés aux identités inconciliables. « La droite réactionnaire est ainsi entraînée dans une dérive antilibérale, voire protofasciste. »
Les auteurs expliquent comment le néolibéralisme a désactivé la lutte des classes, en conduisant les individus à jouer le jeu de la « lutte des places ». Ils racontent comment Thatcher a montré l’exemple en provoquant la grève des mineurs de mars 1984 à mars 1985, après avoir fait des stocks de charbon et formé des unités policières d’ intervention. Elle a criminalisé l’action syndicale en appliquant la consigne de Hayek d’opposer systématiquement la primauté du droit à la revendication sociale. De la même façon aux États-Unis, où le droit du travail est un véritable « modèle » de dérégularisation, les patrons ont provoqué des grèves, facilitant le remplacement des grévistes pour ensuite désyndicaliser les entreprises par un vote. Le procès de France Telecom a mis en lumière les pratiques managériales exceptionnellement brutales mises en oeuvre par la direction. L’unique objectif de ce type de gestion est la maximisation de la performance économique de l’entreprise par l’exigence d’une application totale des individus au moyen d’un « management par objectifs et autocontrôle ». L’ offensive néolibérale ambitionne également de démanteler l’institution du salariat, construite autour du « compromis fordiste », pour lui substituer la norme de l’auto-entrepreneur, travaillant de façon flexible et ne bénéficiant pas de protections sociales et juridiques. Michel Foucault avait déjà pointé, dans son cours au Collège de France de l’année 1978-1979, la substitution de la notion de « force de travail » par celle de « capital humain », opérée par le théoricien de l’école de Chicago Gary Becker. « Si chaque individu est responsable des investissements qu’il fait ou ne fait pas, et donc de sa réussite comme de ses échecs, c’est que tout individu se définit par le “capital“ qu’il constitue pour lui-même et qu’il lui revient d’investir en faisant chaque fois les bons choix, que ce soit en matière d’éducation ou de santé ou sur le plan professionnel au matrimonial. » Dès lors, dans cette culture de la performance, il n’y a plus que des échecs individuels, sans causes sociales. Les auteurs concluent que « la lutte sociale doit viser autant la déconstruction ou la transgression des normes néolibérales que la production et l’invention de normes et de valeurs alternatives. »
« La guerre civile dont il est question tout au long de cet ouvrage ne relève pas d’une exagération rhétorique : elle est bien réelle. L’une de ses dimensions les plus manifestent et l’intensité de la répression policière et judiciaire contre tous ceux qui dérange l’ordre social et osent contester le pouvoir, et pas seulement dans les pays dirigés par des autocrates populistes ou dans les états totalitaires comme la Chine. » Le moment actuel de l’histoire politique est caractérisé par l’ « ennemisation » des opposants et des perturbateurs, l’usage d’une violence étatique directe contre des citoyens vu comme des « terroristes », des ennemis des lois fondamentales de l’ordre du marché. La sécurité prime sur le régime de la souveraineté étatique et se traduit par une inflation des exceptions dans le but de protéger la société. « La violence d’État contre les gouvernés n’est certes pas chose nouvelle. Elle est l’histoire même de l’État, n’en déplaisent à ses thuriféraires. » La seule réponse aux opposants à leur politique délibérément insécuritaire sur le plan social, dont disposent les États néolibéraux est aujourd’hui policière et pénale. La rationalité stratégique de la guerre intérieure, articulée à celle du gouvernement par la concurrence, est performative en ce qu’elle produit l’ennemi intérieur. La « militarisation de la police » a transformé celle-ci en une « armée intérieure chargée de vaincre des contestataires sur le terrain », sur un modèle qui fait penser à l’Irlande du Nord ou aux territoires palestiniens occupés. La répression devient la priorité de la police, chargée, non plus de garantir le droit constitutionnel de manifester, mais de dissuader le plus de manifestants possible en faisant un usage de la force disproportionné contre des citoyens généralement pacifiques. Ainsi, la violence exceptionnelle déployée contre le mouvement des Gilets jaunes fut une réponse directe au contenu massivement égalitaire de ses revendications. La guerre contre le terrorisme a servi de justification au renforcement des pouvoirs et les moyens de police (reconnaissance faciale, police prédictive, surveillance permanente des réseaux sociaux) et a été détournée en guerre contre-insurrectionnelle, étendue à toutes les minorités considérées comme dangereuses, selon le schéma : repérage, écrasement, adhésion de la population générale aux objectifs.
« Toute l’histoire des États modernes serait incompréhensible si l’on n’oubliait que la domination qu’ils ont exercées sur les populations a toujours pris les formes du droit. Même la colonisation a été légale. » « Le droit est à la fois terrain de guerre et instrument de guerre », avec l’intégration dans le droit commun de mesures dérogatoires et l’interventionnisme judiciaire dans le champ politique. Alors qu’historiquement l’État de droit s’est construit en opposition à l’État de police, sa « redéfinition perverse » conduit à la confusion des pouvoirs : le droit « pénal » devient préventif et prédictif, tandis que le droit administratif, de nature préventive, devient punitif et répressif. Désormais, « l’État de droit ne se définit plus par la protection des droits du citoyen contre l’arbitraire de l’État (ce qu’on appelle proprement la “sûreté“ et non la sécurité), mais par la forme de la loi, quel qu’en soit le contenu. » « La guerre du droit, sur le plan politique interne, est une stratégie judiciaire apparemment conforme aux principes de l’État de droit et officiellement vouée à le défendre contre les agissements criminels, mais qui vise en réalité des buts politiques, notamment la neutralisation et l’élimination d’adversaires avérés ou prétendus de l’ordre néolibéral. » La guerre du droit pratiquée notamment en Amérique latine, systématise la négation juridique de toute forme de « souveraineté populaire ». Les auteurs parlent d’ « État de droit privé », dans le sens où l’État lui-même serait soumis à la souveraineté du droit privé.
Si la domination néolibérale dans certaines de ses formes actuelles peut s’appuyer sur les pratiques néofascistes de gouvernement, les auteurs la jugent toutefois aux antipodes du fascisme historique, du nazisme. De même, ils le distinguent du « libéralisme autoritaire ». « L’interventionnisme néolibérale n’est pas seulement économique ou juridique : il est social, il est politique, il est culturel, il est total au sens où le sont les guerres civiles du néolibéralisme ; il investit toute la société parce qu’il ambitionne de faire advenir une société de concurrence. » « Il n’y a de néolibéralisme qu’autoritaire », cette dimension se réalisant à des degrés divers en fonction des opportunités. Au niveau de l’Union européenne, prévaut sur le droit étatique national un empilement de normes dites « communautaires ». « La souveraineté du droit privé y est scellée dans les traités européens », lesquels constituent un « constitutionnalisme de marché » soustrait à tout contrôle démocratique.
Le néolibéralisme recode la rivalité entre les différents intérêts sociaux, notamment la lutte des classes, en « guerre civile » pour mieux poser l’État néolibéral au-dessus des intérêts particuliers. Il s’est toujours soucié de présenter ses politiques comme résultant d’un nécessité et non de choix, disqualifiant toute alternative en la rejetant par avance dans l’impossibilité. C’est pourquoi les auteurs, qui consacrent quelques pages à l’ébauche d’une réponse, insistent pour que toute critique s’attache en premier lieu à « restituer à ces choix toute leur teneur et leur sens de décisions ».
« La souveraineté étatique est une pièce maîtresse dans la construction d’une société de concurrence, et il serait illusoire de prétendre combattre la seconde en laissant de côté la première. L’expérience doit nous immuniser contre toute stratégie suicidaire de retournement contre l’adversaire de ses propres armes. L’État est tout sauf une “arme“ à la disposition des dominés. Seule une politique radicalement non étatique, entendu comme politique du commun, nous faire échapper à l’emprise du marché et à la domination de l’État. » Cette politique du commun doit assumer résolument la conflictualité, y compris sous les formes de l’affrontement physique si nécessaire, tout en l’assumant pour mieux déjouer le piège la guerre civile, comme l’ont fait en leur temps les Communards. Seules des révolutions populaires, seules des révolutions menées et contrôlées par les citoyens, autour d’un projet centré sur l’égalité, la solidarité et l’émancipation,
peuvent s’opposer aux stratégies de guerre civile du néolibéralisme. »
Les « populistes de gauche » cherchent à « construire un peuple » contre des élites mondialisées, mais faisant de la conquête de l’État existant l’enjeu politique central, ils sont incapables de les désarmer. Les auteurs critiquent également « la posture insurrectionnaliste et la violence émeutière » d’une fraction de l’extrême gauche radicale : selon eux, l’autonomie véritable, c’est-à-dire l’autogouvernement, suppose de passer par des actes d’institution.
« La réponse à la guerre néolibérale doit avoir pour axes la lutte pour l’égalité et l’autogouvernement démocratique. » « La démocratie n’est nulle autre chose que la forme générale du lien politique entre personnes égales, conscientes et responsables du sort commun, à petite comme à grande échelle. » Une telle société se construit « dans l’action et l’expérimentation collective contre tout ce qui étouffe l’exercice par tous de leurs droits ».
Cette savante généalogie du néolibéralisme met en lumière les mécanismes scrupuleusement occultés de celui-ci. Si l’esquisse d’une stratégie pour les saboter semblera sans doute un peu légère (ce n’était toutefois pas l’intention annoncée des auteurs), la simple mise-à-nue est déjà fort inspirante. Pierre Dardot, Haud Guéguen, Christian Laval et Pierre Sauvêtre contribuent néanmoins à échapper au piège sémantique dans lequel nous enferment les tenants du néolibéralisme de droite comme de gauche en accusant les opposants à leurs politiques, de menacer l’ordre établi par la « guerre civile ». Cet ouvrage s’emploie à renverser le stigmate. Indispensable, assurément.
Ernest London
Le bibliothécaire-armurier