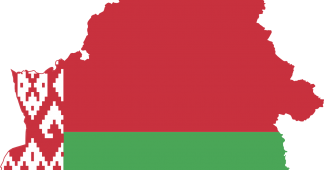Des lois sur le « devoir de vigilance » ont récemment été adoptées ou sont en cours de discussion. L’enjeu est de contrôler le respect des droits humains et environnementaux par les entreprises. Et d’en finir avec l’impunité. Les expectatives suscitées par ces initiatives – surtout au Nord – égalent les frustrations qu’elles risquent de soulever. Leur efficacité dépendra de leur capacité à corriger, voire à renverser l’asymétrie de pouvoir entre multinationales et organisations sociales.
Par Frédéric Thomas [1].
À l’heure où j’écris ces lignes, se prépare, au Qatar, la coupe du monde de football. Celle-ci se jouera dans des stades climatisés, construits par des travailleur·euses migrant·es – dont plusieurs milliers sont morts au cours de ces constructions –, travaillant et vivant dans des conditions indignes, et sans droit d’association ni de créer des syndicats.
Cet événement – et les polémiques qu’il suscite – constitue un révélateur de la situation actuelle. Non seulement de la chaîne des responsabilités prises dans les rets de la globalisation et de l’imbrication des États et des entreprises à l’origine des violations des droits humains, mais aussi de la contestation croissante, au niveau mondial, de la prétendue irresponsabilité du marché, et, enfin, de la défaillance des mécanismes existants pour contraindre les acteurs publics et privés à répondre de leurs actes et de leurs conséquences.
La FIFA (Fédération internationale de football association), qui brasse des centaines de millions d’euros annuellement, est officiellement une association à but non lucratif. Ce statut témoigne jusqu’à l’absurde de l’absence de définition en droit des multinationales – un sujet « largement non identifié » (Bauraind et Van Keirsbilck, 2020) –, se cachant derrière une série d’entités juridiques distinctes, alors qu’elles constituent l’un des acteurs majeurs de la mondialisation.
Ce flou juridique, la non-prise en compte de l’internationalisation des activités des entreprises, la complexité des chaînes de valeur, le manque de transparence, l’usage de paradis fiscaux sont autant les fruits des bouleversements économiques de ces dernières décennies, que la stratégie mise en place pour augmenter la marge de manœuvre (et leurs profits) des multinationales, tout en leur permettant l’évitement systématique de leurs responsabilités.
Par multinationale – aussi (firme ou société) transnationale, nous emploierons les deux termes –, nous nous en tenons ici à la définition simple d’une structure économique active dans plusieurs pays, par le biais généralement de ses filiales, mais possédant un centre principal de décision. Dans ce nouveau volume Alternatives Sud, nous nous centrons sur les plus importantes d’entre elles, dont la majorité ont leur siège aux États-Unis, et de plus en plus en Chine et à Hong-Kong.
Devoir de vigilance ?
Les « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme » des Nations unies, adoptés en 2011, constituent à ce jour, la formulation la plus importante du « devoir de vigilance » (due diligence en anglais). D’autres institutions internationales, telles que l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont également adopté leurs propres instruments sur base de ces principes. « Ils constituent depuis le cadre de référence mondial en matière de respect des droits humains, sociaux et de l’environnement par les entreprises » (Wintgens, 2022a).
Par devoir de vigilance, on entend l’obligation pour les acteurs privés d’adopter une conduite responsable et une diligence raisonnable dans leurs activités, tout le long de la chaîne de valeurs, depuis la prévention des risques jusqu’à l’atténuation et la réparation des éventuels dommages causés. Il repose sur trois piliers : le devoir des États de protéger les droits humains et de prévenir la violation de ces droits par des tiers ; la responsabilité des entreprises de respecter ces droits ; et la nécessité pour les personnes affectées par les activités des entreprises d’accéder à des mécanismes de réparation.
Le devoir de vigilance trouve son origine dans les limites de la « responsabilité sociale des entreprises » (RSE), qui s’est généralisée dans les années 1990, pour intégrer de manière volontaire des préoccupations d’ordre social, environnemental et de droits humains (Wintgens, 2022b). Cette mesure s’inscrivait dans le contexte de mondialisation accélérée des activités économiques, de visibilisation accrue de l’impact des entreprises, et de mobilisation croissante contre le laisser-faire. Au vu de l’insuffisance manifeste de la RSE, et alors que s’opérait la reconfiguration des chaînes de valeur mondialisées, après six ans de négociation, ont été mis en place les Principes directeurs en 2011.
L’effondrement, deux ans plus tard (le 24 avril 2013), au Bangladesh, du Rana Plaza, abritant des ateliers de confection textile pour les marques internationales de l’habillement, devait tragiquement démontrer l’échec de cette vision [2]. Celui-ci relève de l’origine et de la nature mêmes de ces principes. Ceux-ci sont nés d’un consensus entre des acteurs aux intérêts divergents, sinon antagonistes, et aux pouvoirs asymétriques, sans ou avec peu de participation d’organisations de la société civile. De plus, l’accord s’est réalisé autour de dispositifs non contraignants, laissant aux entreprises le soin de les appliquer.
Mais, ces dernières années, dans la foulée de critiques de plus en plus importantes de la globalisation néolibérale, et sous la pression des mouvements sociaux, syndicats et ONG, des initiatives législatives ont été prises – notamment en France, en Allemagne, en Norvège – ou sont en cours de discussion – entre autres en Belgique, au sein de l’Union européenne (UE) –, en vue d’établir un cadre contraignant au devoir de vigilance. En outre, depuis 2014, un « instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’homme » est en négociation à l’ONU [3].
Tant les instruments légaux que les espaces de mobilisation apparaissent largement entremêlés et complémentaires. En Belgique, la coalition des organisations de la société civile, coordonnée par le CNCD-11.11.11 et son homologue néerlandophone 11.11.11., a publié un Mémorandum (2020) et participe de la mobilisation européenne [4]. Au niveau du traité en cours de discussion à l’ONU, la « campagne mondiale pour la reconquête de la souveraineté des peuples, le démantèlement du pouvoir des sociétés transnationales et la fin à l’impunité » a joué – et continue de le faire – un rôle moteur (lire dans cet Alternatives Sud l’article de Gonzalo Berrón et de Brid Brennan).
Les expectatives suscitées aujourd’hui par ces initiatives égalent les frustrations qu’elles risquent de soulever demain, à l’heure de leur mise en œuvre. Au centre des débats : le champ d’application du devoir de vigilance – à toutes les entreprises ou aux plus grandes seulement ; à tous les secteurs économiques ou à ceux jugés stratégiques, critiques ou sensibles ; tout le long de la chaîne de valeur ou sur un segment identifié et formalisé de celle-ci –, son ambition – obligation de moyens ou de résultats ? (Wintgens, 2022a) –, ainsi que l’accès à l’information et à la justice, le rôle des parties prenantes, les moyens de contrôle, etc. On en trouve l’écho dans les neuf articles, dont plusieurs originaux, rassemblés dans ce numéro d’Alternatives Sud.
Mais quelle que soit l’appréciation portée sur les lois adoptées et les débats en cours, au moins peut-on s’accorder sur le fait qu’ils constituent déjà une victoire symbolique, en ce qu’ils renvoient l’autorégulation des entreprises – comme du marché – à ce qu’elle est : un mythe. Et replacent la question des droits au cœur des enjeux. Reste néanmoins à donner au symbole des effets pratiques, en faisant du devoir de vigilance un moyen de contrôle aux mains des communautés et des organisations sociales, y compris syndicales, plutôt qu’un cadre théorique et abstrait, une simple checklist, voire un outil de communication au bénéfice des entreprises.
Failles et hors-champs
À l’encontre de l’image réductrice qui fait des entreprises des acteurs neutres, tout au plus victimes ou prisonnières des régions problématiques où elles opèrent, elles ne cessent en réalité d’interagir avec le contexte, au point, régulièrement, de contribuer à le modeler. Particulièrement dans les zones conflictuelles, où les transnationales apparaissent comme des acteurs clés.
Les cas de la République démocratique du Congo, de la Colombie et de la Palestine, étudiés dans cet ouvrage collectif, sont emblématiques. Les conclusions de l’étude récente commanditée par Solsoc [5], avec deux autres ONG belges, FOS, IFSI, le syndicat socialiste, FGTB-ABVV, et leurs partenaires colombiens, sur les potentialités d’un devoir de vigilance contraignant en Colombie, confirment son enjeu stratégique, ainsi que les caractéristiques propres à l’activité économique au sein de l’ensemble des zones de conflits [6].
Ainsi, force est de constater le caractère généralisé, et même systématique, des violations des droits humains qui y sont commises par les entreprises, le plus souvent en collusion avec les gouvernements sur place, et l’indifférence ou le soutien implicite des États où elles ont leur siège. Les multinationales ont non seulement tiré parti du manque de volonté politique de respecter les droits humains, de la culture de l’impunité et de la violence en cours, mais elles les ont entretenus et aggravés.
« La réparation des violations des droits humains par les entreprises, affirme Humberto Cantú Rivera dans cet Alternatives Sud, peut avoir un effet dissuasif sur la répétition de situations similaires ». A contrario, dès lors, l’absence de justice alimente et renforce l’impunité, consacrant le manque de confiance des populations envers leur système judiciaire, et octroyant une forme de blanc-seing aux acteurs privés.
L’insuffisante prise en compte de la situation des territoires en conflit, de la gravité et de l’intensivité des violations des droits humains qui s’y commettent ne constitue pas la seule zone d’ombre ou hors-champ des initiatives sur un devoir de vigilance contraignant. En effet, la dimension du genre est très imparfaitement intégrée, alors même qu’en raison des inégalités et de la féminisation du travail – et particulièrement de la sous-traitance –, les femmes sont singulièrement affectées par les activités des transnationales [7]. De même, la situation des peuples indigènes et, de manière générale, des populations vulnérables, est insuffisamment appréhendée.
Par ailleurs, les impacts climatiques sont exclus de l’obligation de vigilance des entreprises, et partiellement ceux sur l’environnement, dont plusieurs articles de ce livre, autour de l’extractivisme minier, révèlent pourtant l’importance stratégique. Enfin, la place et le rôle des victimes et parties prenantes demeurent abstraits et comme suspendus, au risque de consacrer dès lors leur manque d’accès effectif à la justice, faute de mesures concrètes à même de surmonter les « obstacles graves et systémiques » qui les empêchent d’engager des poursuites judiciaires contre des entreprises (European Coalition for Corporate Justice – ECCJ, 2021).
Il convient de remarquer qu’une part de l’ombre et de la dissimulation est propre à la dynamique même des multinationales, qui sont l’objet du devoir de vigilance. Ainsi, la fragmentation et la complication partiellement artificielle des chaînes de valeur, au point de constituer un réseau tentaculaire, ne répondent pas seulement à des impératifs purement fonctionnels, mais aussi à la volonté d’exploiter et d’exacerber les écarts, contradictions et autres « trous noirs » juridiques au sein d’États et entre eux, afin de payer le moins d’impôts possibles, de générer le maximum de bénéfices et de ne pas engager sa responsabilité.
Comment assurer la responsabilité et la redevabilité d’une entreprise au vu de ce manque de transparence organisé ? D’autant plus que la plupart des informations sont entre ses mains et qu’elle peut se prévaloir du secret des affaires, et, surtout, que la charge de la preuve reste encore et toujours – y compris dans les initiatives en cours de discussion – du ressort des victimes et parties prenantes.
Nord-Sud
Si la question des violations des droits humains par les entreprises se pose au Nord comme au Sud, elle ne relève pas des mêmes enjeux et ne se prête pas aux mêmes stratégies. Il faut ainsi rappeler la pression que le modèle économique fait peser sur les pays du Sud. Le cas de l’exploitation minière est significatif : c’est la consommation du Nord et de la Chine qui pousse la frontière extractive, exacerbant une exploitation destinée à l’exportation. Ce faisant, elle accroît les conflits, intensifie la criminalisation des mouvements sociaux et affecte l’environnement. Les risques, les impacts et les dégâts sont de la sorte externalisés.
Jusqu’à quel point le devoir de vigilance reproduit-il ou corrige-t-il une division internationale du travail, héritée du colonialisme et consolidée au cours de la globalisation néolibérale, qui a assuré l’essor des multinationales, tout en étant amplement pilotée par celles-ci ? Une division internationale du travail qui constitue un terreau propice aux violations des droits humains. Loin d’être vierge, le terrain d’application du devoir de vigilance est, en effet, miné et cadenassé par un ensemble de rapports de pouvoirs asymétriques.
La délocalisation des emplois, la déréglementation et l’informalisation du travail, la flexibilisation de la main-d’œuvre et la subordination des femmes dans les entreprises, le recours à la sous-traitance « en cascade », l’affaiblissement des syndicats et, de manière générale, de la marge de manœuvre des politiques et institutions publiques, tout particulièrement dans les pays du Sud, ne constituent pas une donnée « naturelle » du marché, mais la résultante de choix stratégiques.
Des choix confirmés et reproduits par les accords de libre-échange, les traités bilatéraux, et protégés par les tribunaux d’arbitrage privé (Ferrari, 2022). Les mesures mises en place pour attirer les investissements étrangers et les politiques des institutions financières internationales verrouillent la voie tracée, qui sanctionne, en fin de compte, la primauté du marché sur les droits humains et dessinent ce que Berrón et Brennan nomment, dans ce numéro, une « architecture d’impunité ».
Ce n’est pas seulement, dès lors, la cohérence des politiques qui est en question, mais aussi et surtout la camisole de force que cette architecture impose au devoir de vigilance, même contraignant, et, a contrario, sa puissance potentielle, à même de bousculer et d’ouvrir une brèche dans cette charpente. Or, la réponse réside en partie dans la déclinaison Nord-Sud de cette stratégie.
Les initiatives actuelles sur le devoir de vigilance se caractériseraient-elles encore (trop) par une approche du « haut vers le bas » et du Nord vers le Sud ? Certes, des organisations du Sud participent, directement ou via leurs réseaux, aux campagnes internationales autour de ces initiatives. Et il convient de rappeler en outre que ce sont deux États du Sud, l’Équateur et l’Afrique du Sud, qui sont à l’origine de la proposition d’un traité contraignant à l’ONU ; proposition freinée et entravée par les États-Unis et l’Europe. Mais, il faut reconnaître, avec Jean-Pierre Okenda (lire son article dans cet Alternatives Sud), que, de manière générale, il existe au sein des populations, une asymétrie entre l’engouement au Nord et le désintérêt ou la méconnaissance au Sud.
S’agit-il d’opérer une régulation sous bannière occidentale, voire états-unienne, ou de rééquilibrer les rapports Nord-Sud ? De « répondre aux objectifs cosmétiques des marchés » ou de « résoudre les défis structurels » auxquels les populations du Sud font face (Okenda) ? Les débats complexes sur l’extraterritorialité de la justice, qui traversent plusieurs des articles qui suivent, doivent, en conséquence, tenir compte de ce questionnement.
Au-delà du manque de moyen et/ou de volonté des gouvernements du Sud, l’enjeu est bien l’accès à la justice et à la réparation, tout en faisant en sorte, comme l’avancent Gurumurthy et Chami ici-même, de garantir et d’accroître la capacité d’action des populations et des institutions publiques – dont le système judiciaire et les autres mécanismes pour obtenir réparation – du Sud.
Asymétrie de pouvoirs
Les débats en cours au sein de l’ONU, de l’UE et de diverses enceintes parlementaires nationales, dont la Belgique, autour d’un devoir de vigilance contraignant, sont un marqueur des rapports de pouvoirs entre les États, les entreprises et les organisations sociales, et entre le Nord et le Sud. Le risque est que ces initiatives occultent – et par-là même renforcent – plutôt qu’elles ne combattent ces relations asymétriques de pouvoir entre les multinationales, d’un côté, et les sujets sociaux (et au sein de ceux-ci entre classes sociales, rapports sociaux de genre et de « race »), de l’autre. Les États étant, quant à eux, souvent (surtout au Sud) dominés face aux premières, et dominants à l’encontre des seconds.
L’asymétrie traverse et structure tous les rapports sociaux, mettant à mal l’objectif d’obliger les entreprises à réparer les dommages et violations dont ils sont à l’origine. Plus que tout, elle constitue un obstacle majeur à la participation des parties prenantes et à l’accès à la justice. Les tribunaux demeurent très majoritairement hors de portée des victimes, multipliant les obstacles : de temps, d’argent, d’information, de compétences techniques, etc.
Et lorsqu’une procédure aboutit, encore faut-il qu’elle soit appliquée. Comme l’écrivent Gonzalo Berrón et Brid Brennan (voir plus loin), lorsque la décision de justice est favorable aux victimes, « elles éprouvent des difficultés dans leur mise en œuvre, car les autorités donnent rarement suite aux décisions qui profitent aux communautés affectées. Mais lorsqu’il s’agit de décisions favorables aux entreprises, elles procèdent avec diligence ». Cette asymétrie juridique se nourrit et prolonge l’inégalité des rapports sociaux.
Le défi est donc de casser ce deux poids deux mesures. Cela suppose de donner davantage de pouvoirs aux sujets sociaux. Et, pour ce faire, que le devoir de vigilance soit un outil entre leurs mains. Mais, pour qu’ils puissent se l’approprier, encore faut-il que le dispositif s’y prête ; d’où l’attention particulière accordée à la participation des parties prenantes dans le contrôle et la mise en œuvre des plans de « due diligence ».
Parmi les parties prenantes, une place particulière doit être reconnue aux syndicats. Si ceux-ci sont partisans d’un devoir de vigilance contraignant, ils témoignent avec raison d’une certaine défiance envers la mise en avant d’un nouvel outil, alors même que certains – qu’ils ont eux-mêmes contribué à forger, tels que le dialogue social et la négociation – existent déjà de longue date, mais ne sont pas respectés, appliqués, voire sont combattus. L’intérêt d’une nouvelle loi ne doit pas faire oublier qu’une part importante des problèmes réside dans la non-application des règles existantes (et dans le manque de volonté de les appliquer) ni servir d’excuse à la non-ratification de conventions de l’OIT et, plus globalement, à l’affaiblissement des clauses sociales et environnementales des traités et accords.
Néanmoins, la nécessité de mécanismes contraignants ne fait guère de doute au vu de la détérioration des droits des travailleurs et travailleuses, selon la Confédération syndicale internationale (CSI) – dans les trois-quarts des États, le droit de former un syndicat n’est pas respecté, et près de neuf pays sur dix (87%) viole le droit de faire grève – qui appelle à « reconstruire notre monde sur la base d’un nouveau contrat social » (CSI, 2022).
Mais l’asymétrie trouve aussi sa source et ses relais dans une dimension idéologique et symbolique, qui met les droits humains en concurrence avec les intérêts économiques, faisant des premiers un « désavantage comparatif », de toute façon subordonnés au marché. Ainsi, un récent rapport du PNUD note qu’« alors que les pays africains se font concurrence pour attirer les investissements directs étrangers, on a souvent l’impression que le respect des droits de l’homme par les entreprises n’attire pas les investissements. (…) l’insistance sur le respect des droits de l’homme est considérée comme interférant avec la facilité de faire des affaires » (PNUD, 2022).
Les accusations et poursuites en justice de diverses multinationales, facilitées notamment par la mise en œuvre de la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance, permet de visibiliser davantage et mieux les violations des droits humains dont sont responsables les entreprises, et, par ricochet, le manque de volonté du gouvernement français d’assurer le contrôle et la mise en œuvre de cette loi (Le radar du devoir de vigilance, 2021). Elles offrent de la sorte un outil qui contribue à renverser cette asymétrie symbolique et pratique.
Le respect des droits humains, sociaux et environnementaux est une affaire trop sérieuse pour le laisser aux mains des entreprises. Et les violations de ces droits ne sont pas des accidents de parcours ou des dégâts collatéraux, mais les conséquences d’un modèle économique. Et de l’impunité dont il jouit. Moins concentrés et médiatisés, des Rana Plaza continuent de s’effondrer tous les ans par le monde. Le devoir de vigilance est autant un signe qu’un appel. De l’action des communautés indigènes et ethniques, des mouvements paysans et de femmes, des syndicats et autres organisations sociales – et, plus encore, des alliances qu’ils construiront entre eux – dépend largement son efficacité à contribuer à corriger, sinon à renverser l’asymétrie de pouvoirs.
Footnotes
[1] Docteur en sciences politiques, chargé d’étude au CETRI – Centre tricontinental, auteur ou coordinateur de plusieurs livres et études sur les rapports Nord-Sud et la mondialisation, dont Le devoir de vigilance en Colombie (2022), Accords de libre-échange : cinquante nuances de marché (2017), Industries minières : extraire à tout prix ? (2013), etc.
[2] Voir à ce sujet, les coalitions belge (Achact, https://www.achact.be/) et internationales (Clean Clothes Campaign, https://cleanclothes.org/).
[3] Traité connu comme « Binding Treaty ». Voir https://www.business-humanrights.org/fr/.
[4] Voir https://www.devoirdevigilance.be/. Et « Devoir de vigilance : la proposition de la Commission européenne doit être renforcée », 12 mai 2022, https://www.cncd.be/Devoir-de-vigilance-la-proposition.
[5] Étude sur le devoir de vigilance vu par les organisations partenaires colombiennes de FOS, IFSI et Solsoc, 2022
[6] Lire à ce propos, à partir de l’exemple du conflit actuel en Ukraine, European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) et Frank Bold, From rushed reactions to proper preparedness. Corporate due diligence in times of armed conflict, 2022.
[7] Une coalition, Féministes pour un traité contraignant (F4BT), s’est d’ailleurs mise en place : https://poderlatam.org/en/2020/10/feminists4bindingtreaty-recommendations-second-draft/
We remind our readers that publication of articles on our site does not mean that we agree with what is written. Our policy is to publish anything which we consider of interest, so as to assist our readers in forming their opinions. Sometimes we even publish articles with which we totally disagree, since we believe it is important for our readers to be informed on as wide a spectrum of views as possible.