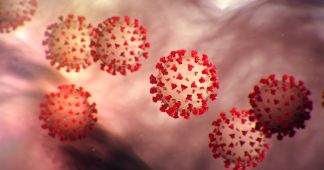Par Maxime Lerolle
20 avril 2021
Le plastique empoisonne la terre, les océans, et l’ensemble du vivant. Ses microparticules sont omniprésentes, au point que nous en ingérons quotidiennement. Et pourtant, montre l’enquête de Dorothée Moisan, les patrons de cette industrie se battront jusqu’au bout pour leurs profits.
Saviez-vous qu’un sachet de thé en plastique infusé dans l’eau à 95 °C relâche près de 11,6 milliards de microplastiques et 3,1 milliards de nanoplastiques dans une simple tasse ? Que nous ingérons chaque semaine cinq grammes de matières plastiques, soit l’équivalent d’une carte de crédit ? Ou encore qu’en 2020, la production, l’élimination et l’incinération de matières plastiques avaient rejeté autant de gaz à effet de serre que 189 centrales à charbon, et qu’au rythme de croissance de cette industrie, ces émissions devraient équivaloir à celles de 619 centrales en 2050 ?
Les Plastiqueurs. Enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent (éd. Kero) regorge de telles joyeusetés. Dans cette enquête approfondie, la journaliste Dorothée Moisan brosse un panorama de l’industrie plastique — les fameux « plastiqueurs » —, allant de ses impacts sanitaires et environnementaux à ses projets d’adaptation à la transition écologique, en passant surtout par ses manœuvres retorses pour défendre ses intérêts, quoi qu’il en coûte au vivant. Car, comme son retour en grâce avec la pandémie de Covid-19 l’aura montré, « le plastique n’est pas mort. Il n’est même pas en fin de vie. Il bouge plus que jamais. »
« Un tueur silencieux »
Pour qualifier l’action des plastiqueurs sur la planète, Dorothée Moisan use d’une autre expression, aussi juste que glaçante : l’industrie plastique agit comme « un tueur silencieux ». Tueur, car on ne compte plus les ravages de cette industrie. Si l’opinion publique s’est depuis longtemps focalisée sur le fameux « océan de plastique », elle oublie que les gyres où tourbillonnent ces déchets ne représentent qu’une infirme portion émergée de l’iceberg. Pris dans leur globalité, ce sont « 99 % des plastiques qui atteignent les côtes qui deviennent ensuite invisibles ». À trop nous concentrer sur quelques phénomènes surmédiatisés, on ne voit plus l’empoisonnement systématique de la planète et de ses habitants par le plastique.
On ne parle ainsi que rarement des sols, vingt-quatre fois plus pollués par les microparticules plastiques que les océans, dans lesquels les « poussières de plastique s’immiscent désormais dans les fruits et légumes », menaçant « la sécurité alimentaire au niveau mondial ». Quant à la santé humaine, elle est tout autant empoisonnée. Citant une enquête de Santé Publique France, l’autrice rapporte ainsi que « 100 % des Français, adultes et enfants, sont “imprégnés” de composés fluorés, mais aussi de bisphénols (A, F et S), de phtalates, de parabènes, d’éthers de glycol et de retardateurs de flamme ». Mais on n’évoque pas cette épidémie-là.
Et pour cause : depuis des années, les plastiqueurs ont sciemment fabriqué du doute sur toute étude les mettant en cause. À la force de ses lobbyistes et de subventions à des recherches n’incriminant pas les plastiques, les plastiqueurs ont réussi, comme l’industrie du tabac avant eux, à échapper aux réglementations politiques contraignantes. Même l’Union européenne, pourtant la région du monde qui protège le mieux les consommateurs, peine à percer leurs ruses. Dernier exemple en date : le bisphénol A. Face aux études scientifiques qui, de plus en plus nombreuses, mettaient en lumière les effets de ce perturbateur endocrinien — cancer, puberté précoce, diabète, obésité ou encore baisse de la fertilité —, l’industrie a trouvé la parade : lui substituer le bisphénol S, à la structure chimique quasiment identique mais qui présente l’avantage de n’avoir pas encore été aussi minutieusement décortiqué que le bisphénol A. Et en l’absence de consensus médical, la bureaucratie européenne ne peut réglementer son usage. « À ce jeu du chat et de la souris, l’industrie du plastique a l’avantage face au gros matou européen bien trop lent pour attraper tous les nouveaux mulots chimiques qui déboulent chaque jour sur le marché », déplore Dorothée Moisan.
À l’inverse, afin de redorer leur image, les plastiqueurs ont entrepris depuis les années 1990 un vaste projet d’écoblanchiment, qui a pour nom : le recyclage. Contrairement à ce qu’on pourrait naïvement penser, seule une infime partie (9 % des résidus plastiques à l’échelle mondiale) des déchets de la fameuse poubelle jaune sont effectivement réemployés pour fabriquer des produits d’une qualité équivalente. L’écrasante majorité d’entre eux (91 %) servent à des usages d’une moindre qualité (comme de combustible pour l’industrie), quand ils ne sont pas expédiés par cargos entiers en Asie pour y finir dans des décharges à ciel ouvert.
Logique coloniale
Mais les plastiqueurs peuvent aussi imposer leur loi du silence plus brutalement. Pour ce faire, ils s’inscrivent, comme tant d’autres industries, dans les structures coloniales, sinon racistes, du capitalisme globalisé. La chose est particulièrement frappante dans le sud des États-Unis. En Louisiane, la région qui s’étend de Bâton-Rouge à La Nouvelle-Orléans est tristement surnommée « Cancer Alley », tant les usines pétrochimiques dégradent la santé des riverains. Et si personne n’écoute leurs récriminations, c’est parce qu’ils sont Noirs et pauvres. Rapportant les propos d’un activiste louisianais, la journaliste note que « les communautés touchées sont noires, les décideurs sont blancs : la politique est raciste ». De ce point de vue, « l’industrie du plastique n’a fait que se substituer à l’industrie coloniale et esclavagiste des planteurs de coton ».
Une même logique affecte le traitement des déchets. Jusqu’en 2018, la Chine absorbait la plupart des déchets plastiques dont les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie ou le Japon souhaitaient se débarrasser incognito. Or, en 2018, le gouvernement de Xi Jinping a décidé de donner un « coup de sabre » dans ce commerce et d’en réduire drastiquement les importations. Qu’à cela ne tienne : plutôt que chercher à diminuer la masse des déchets plastiques, les exportateurs occidentaux ont immédiatement déversé leurs déchets dans les pays voisins de la Chine. « En l’espace d’une nuit, la Malaisie, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines, l’Inde ou encore la Thaïlande ont vu leurs villages se transformer en décharges », observe Moisan. La boucle est ainsi bouclée, les pays du Sud récupérant les matières premières que ceux du Nord ont pillées chez eux — mais sous forme d’ordures.
Contre une industrie aussi puissante, comment résister ? Il va de soi que les célèbres « écogestes » que prônent les plastiqueurs ne résolvent en rien le problème, servent à culpabiliser les consommateurs et à dédouaner de toute responsabilité les industriels. Alors, quelle échelle de lutte privilégier ? L’échelon national, voire régional, paraît insuffisant, en témoignent les contre-exemples chinois et européen. Malgré des réglementations de plus en plus fortes, à l’instar de la directive interdisant les plastiques à usage unique à compter de 2021, l’Union européenne ne parvient pas à contrôler ses industriels. Sentant le vent tourner en Europe, plusieurs d’entre eux ont tout simplement délocalisé le « recyclage » de leurs déchets en Turquie, où ils connaissent le même sort qu’en Asie du Sud-Est. De même, sous la pression politique, « Coca-Cola a fini par s’engager à soutenir les systèmes de consigne en Europe occidentale. En Europe, oui, mais en Europe seulement. » De telles mesures, ne faisant que cacher ce plastique qu’on ne saurait voir, ressemblent à s’y méprendre au syndrome Ninby — « Not in my backyard » (« Pas dans mon arrière-cour »).
Beaucoup plus ambitieuse que l’Union européenne, l’Afrique se trouve à la pointe de ce combat. Jusqu’à présent, seuls les États africains ont vraiment réussi à se prémunir de la pollution plastique. Sur les cinquante-quatre nations du continent, trente-quatre ont légiféré pour réduire l’usage des sacs plastiques ; la moitié d’entre elles les ont tout bonnement interdits. Parmi celles-ci, le Kenya et le Rwanda, réputés être les pays les plus répressifs au monde en la matière, plaident pour une collaboration à l’échelle planétaire de la lutte contre les plastiques. Inquiétés par les rumeurs d’un plastic deal qui autoriseraient les États-Unis à déverser leurs déchets sur le continent, plusieurs gouvernements africains — rejoints par des militants du monde entier — estiment en effet que seul un traité international permettrait « de plafonner la production de plastique vierge ». L’occasion, enfin, de troquer Ninby pour Nina — « Ni ici, ni ailleurs ».